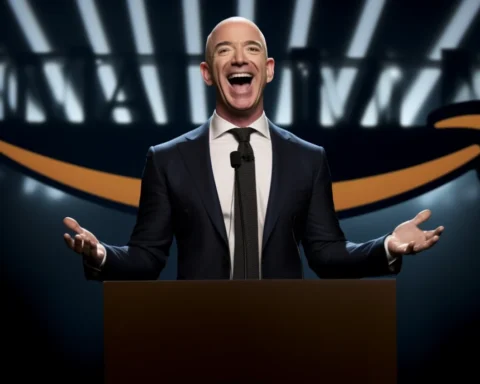Dans une tentative audacieuse de modifier l’alignement financier traditionnel, un groupe de passionnés de cryptomonnaies en Suisse, connu sous le nom de 2B4CH, a initié une campagne pour faire inscrire Bitcoin dans la Constitution fédérale suisse. Focalisée sur la modification de l’article 99, paragraphe
Lire l'articleMagazine sur la finance & l'économie
A la Une
Les cryptomonnaies ont rebondi, le bitcoin évolue désormais au-dessus des 65 000
Vous avez un ou plusieurs crédits ? Vous aimeriez simplifier la gestion
Ce n’est un secret pour personne, le marché immobilier est en plein
Le Bitcoin fait de nouveau parler de lui avec la hausse de son prix ces derniers mois mais surtout avec son son quatrième
Une étude récente a classe les 10 villes parmi lesquelles il n’est pas rentable d’acheter un bien immobilier. Dans ces villes, il est
Avec l’avènement des technologies financières et l’essor de l’économie numérique, les actifs du monde réel (RWA) deviennent progressivement accessibles au grand public. La
Le 13 avril, l’Iran a frappé Israël, provoquant un séisme financier inattendu. Imaginez : en un éclair, le Bitcoin dégringole, chutant de presque
Le halving du Bitcoin, un événement qui se produit environ tous les quatre ans, consiste à diviser par deux la récompense distribuée aux
Depuis 2017, la zone euro a mis en place un nouveau moyen de paiement : le virement instantané. Il permet le transfert d’argent
Bourse
Crédit
Crypto
Être millionnaire grâce aux bitcoins fait rêver beaucoup de monde. Avec l’évolution du marché et la montée en flèche des cours ces
Lire l'articleAlors que l’investissement immobilier devient de plus en plus complexe, les jeunes générations se tournent davantage vers les cryptomonnaies. Une récente étude
Lire l'articleLe Bitcoin, première et plus célèbre des monnaies numériques, a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2009. Suscitant engouement, fantasme,
Lire l'articleLe marché des cryptomonnaies connaît actuellement une phase haussière remarquable. Certains investisseurs redoublent d’efforts pour trouver les meilleures opportunités et maximiser leurs
Lire l'articleEn réponse à la méfiance croissante de la communauté crypto envers Cardano, Charles Hoskinson, fondateur du projet, a affiché sa détermination défendant
Lire l'articleL’heure est à la consolidation et à l’hésitation pour le marché des crypto-monnaies juste avant le halving du bitcoin. Voici un résumé
Lire l'articleL’année 2018 avait été tumultueuse pour le marché des crypto-monnaies, avec une chute considérable dans leur capitalisation boursière. Nous vous proposons un
Lire l'articleLe 19 janvier 2024, avec une histoire captivante, un homme est devenu millionnaire en un instant, grâce à une impulsion donnée par
Lire l'articleFiscalité
L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est une taxe française apparue en 2018. Elle concerne les propriétaires dont le patrimoine net immobilier
Lire l'articleEn France, plus de 55 millions de personnes possèdent un Livret A. Ce compte d’épargne de nombreux avantages malgré un rendement de
Lire l'articleLA TVa est l’impôt le plus connu en France. Impossible d’y échapper. Cette taxe s’applique sur absolument tous nos achats du quotidien.
Lire l'articleFace à l’omniprésence des smartphones dans la vie quotidienne et leur utilisation croissante pour accéder à Internet, les administrations publiques continuent d’adapter
Lire l'articleLa défiscalisation immobilière suscite l’intérêt de nombreux investisseurs et particuliers en France. Il existe plusieurs dispositifs permettant de bénéficier d’avantages fiscaux dans
Lire l'articleLe 15 mars 2024, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) prélèvera près de 7 millions de contribuables français pour deux types
Lire l'articleLorsqu’on parle de réduire ses impôts, il n’y a pas de seuil réglementaire ou légal minimum. En réalité, la possibilité de diminuer
Lire l'articleLa taxation foncière représente une part importante des prélèvements obligatoires en France pour les propriétaires. Alors qu’elle a déjà lourdement augmenté ces
Lire l'articleImmobilier
L’investissement dans l’immobilier en pierre papier offre beaucoup d’avantages : la diversification immobilière sans achat direct de biens, la gestion professionnelle des
Lire l'articleLe marché immobilier de Megève se distingue par son unicité et sa niche très prisée dans le secteur de l’immobilier de montagne
Lire l'articleEst-il encore possible ou judicieux d’investir dans la pierre une fois atteint l’âge de la retraite ? Les banques peuvent-elles accepter de
Lire l'articleApparu aux États-Unis, le phénomène de « pornographie immobilière » (Real Estate Porn) commence à se développer en France. Que ce soit sur TikTok,
Lire l'articleCes derniers mois, il n’est pas toujours facile de vendre son logement (ou investissement) rapidement et au meilleur prix. Certaines astuces peuvent
Lire l'articleAlors que le printemps commence à pointer le bout de son nez, il semble que le marché immobilier commence à montrer des
Lire l'articleAlors que la construction de logements poursuit sa forte baisse, les professionnels du secteur immobilier continuent de subir des pertes d’emplois. La
Lire l'articleInvestir dans l’immobilier peut sembler difficile pour ceux qui disposent d’un budget limité, notamment pour les personnes qui souhaitent investir moins de
Lire l'articleLe célèbre designer de mode Karl Lagerfeld, décédé en février 2019, avait laissé derrière lui un luxueux héritage, dont l’un des joyaux
Lire l'articleBanques
Epargne
Même si plus de 66% des Français pensent qu’ils n’auront pas de retraite, ou une retraite peu importante, il peut être utile
Lire l'articleAvec les fluctuations économiques actuelles, optimiser vos économies est plus important que jamais. Le Livret A, grâce à sa sécurité et son
Lire l'articleLe Livret A est une solution d’épargne populaire pour les parents qui souhaitent mettre de l’argent de côté pour leurs enfants dès
Lire l'articleVéritable institution de l’épargne en France, le Livret A est un produit d’épargne largement répandu et apprécié pour ses nombreux avantages. Avec
Lire l'articleLa gestion de l’épargne et de la fiscalité représente un défi majeur pour les épargnants, y compris pour les investisseurs les plus
Lire l'articleLe Livret A, censé nous protéger de l’inflation, est bloqué à 3% de rendement depuis le 1er août 2023 tandis que l’inflation
Lire l'articleIl est fréquent que les personnes se demandent ce qu’il advient des comptes bancaires, et notamment du livret A, après le décès
Lire l'articleSi le Livret A est considéré comme le placement préféré des Français en raison de sa simplicité, il n’offre qu’une faible performance
Lire l'articleInvestissement
Professionnel
Questions Réponses
Vous envisagez d’acquérir une maison mobile ou une habitation légère de loisirs (HLL) pour profiter de vos vacances en famille ou entre
Vous êtes curieux de connaître le prix de la chambre d’hôtel la plus chère de France ? Située dans un établissement au
Dans certaines situations, un héritier en France peut souhaiter renoncer à son héritage pour éviter des conflits familiaux, régler des dettes ou
« Le mariage coute cher, mais le divorce encore plus« . Nous avons tous déjà entendu ceci. Aujourd’hui, nous avons décidé de nous y
La présence d’un garant est (très) souvent demandée par les propriétaires pour s’assurer du règlement des loyers. Il s’agit généralement d’une personne
Un voyage de prévu ? Vous souhaitez prendre l’avion avec de l’argent liquide ? Attention, lors de la fouille à l’aéroport, au-delà
Jeffrey Epstein, un financier américain accusé d’avoir exploité et abusé sexuellement de mineurs, a toujours entretenu un certain mystère autour de sa
Avec des milliards de vues quotidiennes et une audience toujours grandissante, YouTube est devenue une plateforme incontournable pour tous ceux qui souhaitent
Dans cet article, nous aborderons la question de la transmission d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA) après le décès du titulaire. Entre
La période des fêtes est souvent synonyme de dépenses importantes, entre les achats de cadeaux et les repas de fin d’année. Pour
Depuis le 5 septembre 2023, lors d’un licenciement pour motif économique, si le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé
Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) est une initiative qui combine formation et/ou soutien professionnel pour la personne embauchée, tout en offrant un
Les personnes âgées ou handicapées aux ressources limitées bénéficient souvent d’aides sociales, c’est un fait. Mais savez-vous que leurs héritiers pourraient avoir
Les Français sont souvent perçus comme travaillant moins que leurs voisins européens. Cette idée reçue trouve-t-elle réellement une base factuelle, ou s’agit-il